La capacité de rêver et de créer 🌙 a façonné Sapiens
Ludovic Slimak est un paléoanthropologue français renommé, spécialisé dans l’étude des premiers Homo sapiens et des Néandertaliens. Ses travaux portent sur l'évolution humaine, en particulier sur les interactions entre ces deux espèces humaines, leur mode de vie, leur environnement et leur créativité.
Illustration : Pierre Guité et Mid-Journey -Trois hominidés tenant un outil, dessinés sur un arrière-plan rouge et beige, représentant l’évolution et la créativité humaine.
Ce que l’on découvre dans Sapiens nu
Le paléoanthropologue a dirigé et participé à de nombreuses fouilles archéologiques en Europe, au Moyen-Orient et ailleurs. Ces fouilles sur les modes de vie des Néandertaliens et des Homo sapiens à travers l'analyse de leurs outils, habitats et restes biologiques permettent de mieux comprendre si ces deux espèces ont échangé des techniques, des idées ou même des gènes, et comment elles ont influencé leur évolution mutuelle.
Ludovic Slimak ne se limite pas à une analyse scientifique rigide. Son approche est multidisciplinaire, mêlant archéologie, anthropologie et philosophie. Il met en avant une vision humaniste de l'évolution humaine, insistant sur la nécessité de comprendre nos origines pour mieux appréhender notre place dans le monde moderne. Pour lui, la capacité à rêver et à imaginer a été l'un des moteurs fondamentaux de l'évolution humaine.
Sapiens nu, un livre formidable !
Son dernier ouvrage Sapiens nu explore la nature de l'humanité, comparant Homo sapiens aux Néandertaliens et examine le rôle de l'imagination, de la culture et des structures sociales dans le façonnement du comportement humain et de l'histoire.
Ludovic Slimak analyse comment l’imagination collective d’Homo sapiens lui a permis de dominer son environnement. Il étudie également comment différentes cultures perçoivent le temps et la mémoire. Enfin, il remet en question les hypothèses couramment admises sur l'intelligence et la conscience en comparant les humains aux animaux et à l'intelligence artificielle.
Les constructions imaginaires
Les populations humaines ne s'installent pas dans des lieux par simple nécessité. Le choix, par exemple, d’ériger un gratte-ciel en plein milieu d’un désert découle plutôt d’une construction imaginaire, d’une vision du monde propre à une culture. Même les tabous entourant l’alimentation relève de l’irrationnel. Certaine populations préfèrent mourir de faim plutôt que de manger certains aliments.
Les pyramides d'Égypte
Les pyramides d'Égypte sont un exemple spectaculaire de mise en oeuvre d’un imaginaire collectif. 6,2 millions de mètres cubes de pierre pour trois pyramides, une construction qui n’a aucune utilité pratique. Que dire des 20 millions de mètres cubes de pierres de taille qui ont été nécessaire pour ériger, en France, les cathédrales au moyen-âge. Ces constructions démontrent la capacité de Sapiens à mobiliser d'immenses ressources pour des projets qui répondent principalement à des besoins imaginaires ou symboliques.
L’imaginaire collectif ne se traduit pas seulement dans la pierre, mais aussi dans les rituels. Pensons, par exemple, aux rituels d’intronisation de l’Académie française.
Les constructions imaginaires d’Homo Sapiens présentent de multiples dangers. L’histoire a connu plusieurs tragédies découlant directement de ces constructions : la Première Guerre mondiale et la montée du nazisme, ou de façon plus générale la propension de notre espèce à faire preuve “d’académisme“ en niant la valeur de ce qui est différent.
Les folies collectives
Slimak va plus loin en affirmant que sociétés humaines vivent dans des « folies collectives » qui leur sont souvent invisibles, ou du moins indétectables à première vue. Pourtant, elles sont si puissantes qu'elles peuvent amener les sociétés à agir contre leurs propres intérêts. Ce qui nous semble rationnel n'est souvent qu'une construction culturelle parmi d'autres.
Non seulement ces constructions de l’imaginaire sont puissantes, mais elles se transmettent et évoluent. Les institutions jouent un rôle clé dans cette transmission. Ainsi que la tension sans cesse alimentée et entretenue entre conformité sociale et liberté individuelle.
Bref, la "matière" de Sapiens n'est pas dans sa chair ou ses os, mais dans ses constructions imaginaires. Ces constructions sont si puissantes qu'elles peuvent nous emporter "malgré nous" dans des dérives de toutes sortes. Nous serions en quelque sorte prisonniers de nos propres mythes.
Le rêve comme fondement de l’humanité.
Le rêve et l’imaginaire sont essentiels pour comprendre l’évolution de l’humanité. Le Rêve, dans les sociétés traditionnelles comme chez les Aborigènes d'Australie, est une clé pour interpréter les origines du monde, les lois sociales et les pratiques spirituelles. Il ne s’agit pas seulement de mythes, mais d’un cadre global pour comprendre l’existence.
« L’âge du Rêve » ou Dreamtime, une structure intemporelle reliant passé, présent et avenir en une seule continuité.
« L’âge du Rêve se réfère à une représentation du monde, de ses origines, son devenir… il exprime un processus de permanence éternelle. »
Mais nos sociétés modernes ont marginalisé le rêve et la créativité. Elles les ont remplacé par des logiques utilitaires et pragmatiques. Cette perte entraîne un désenchantement du monde, où l’imaginaire n’a plus la même place qu’il occupait dans les sociétés anciennes.
Réapprendre à rêver
Nous devons réapprendre à rêver et réinventer nos récits collectifs pour retrouver un équilibre avec le monde naturel. Le rêve et la créativité pourraient offrir une solution aux défis sociaux et environnementaux actuels, car le Dreaming du « Dreamtime » considère le rêve comme un complexe de significations, incarnant une totalité regroupant à la fois la réalité, les croyances et la loi.
Réhabiliter le rêve dans nos vies quotidiennes nous inciterait à repenser nos systèmes éducatifs et contribuerait à rétablir nos liens avec la nature. Toutefois, cela nous forcerait à rompre avec l’obsession de la productivité et à valoriser les petites choses.
Ludovic Slimak démontre que la capacité de rêver et de créer est une spécificité humaine cruciale qui a façonné l’histoire de Sapiens. Dans notre monde moderne, il nous invite à préserver cette aptitude, en insistant sur son importance pour réenchanter nos existences et surmonter les crises contemporaines.
Les mises en garde de Ludovic Slimak
Illustration : Pierre Guité et Mid-Journey - Une silhouette humaine entourée d’autres figures abstraites, évoquant l’unité et les dynamiques de groupe.
Le paléoanthropologue et philosophe met en lumière la propension de Sapiens à se conformer aux normes collectives et en tire des leçons cruciales pour les sociétés modernes, en particulier en ce qui concerne l'utilisation des médias sociaux.
Une efficacité redoutable mais dangereuse
Slimak explique que cette propension à se conformer a permis à Sapiens de développer une « machine à faire groupe » extrêmement efficace, favorisant l’unité et la cohésion sociale. Cependant, il souligne que cette efficacité a un coût : l’effacement de l’individu et de sa liberté au profit du collectif. Ce mécanisme, bien qu’utile à la survie et à l’évolution, présente des dangers lorsqu'il devient incontrôlé.
Dans le contexte des médias sociaux, cette tendance se manifeste par la formation de bulles de filtrage et d’échos, où les individus renforcent mutuellement leurs idées sans les remettre en question. Cela amplifie les phénomènes de polarisation et de conformisme, renforçant des normes collectives parfois toxiques.
Les risques d’hyperefficacité
Slimak avertit que cette dynamique d’uniformité et de soumission aux normes collectives peut engendrer une intolérance à la diversité et une opposition à la différence. Les médias sociaux exacerbent ce phénomène en favorisant les contenus polarisants et émotionnels, qui exploitent cette propension à l’unité contre la diversité.
Il note que cette « machine à faire groupe » peut non seulement marginaliser les voix divergentes, mais aussi produire des dynamiques de groupe dangereuses, comme celles qui ont conduit à des atrocités historiques. Les algorithmes des plateformes, en accentuant ces tendances, alimentent des comportements de meute ou des mouvements de masse irrationnels.
Le paradoxe de l’individu dans le collectif
Slimak souligne également que, bien que Sapiens ait un besoin instinctif d’appartenance, ce même besoin peut devenir un frein à l’émergence de la liberté individuelle. Dans les médias sociaux, cela se traduit par une pression sociale constante qui pousse les utilisateurs à se conformer à des attentes collectives (comme les tendances ou les mouvements populaires), réduisant leur capacité à exercer un esprit critique.
Une nécessité d’émancipation
Pour Slimak, l’enjeu pour les sociétés modernes est d’encourager l’émancipation des individus face aux dynamiques collectives écrasantes. Il appelle à une réinvention des récits qui valorisent la liberté, la diversité et l’individu.
En ce qui concerne les médias sociaux, cela implique :
Un usage plus conscient de ces outils pour éviter les manipulations et la soumission à des tendances manipulées par les algorithmes.
La promotion d’une pensée critique, capable de résister aux effets de groupe et aux normes sociales destructrices.
Source :
Slimak, Ludovic, Sapiens nu - Le premier âge du rêve. Éditions Odile Jacob.
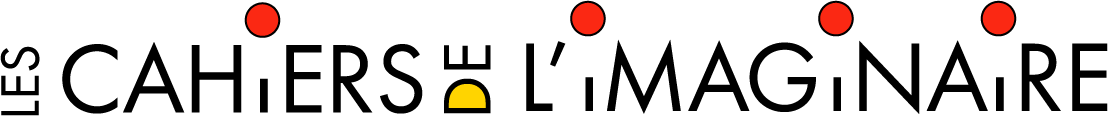



Découvrez comment le rêve et la créativité ont façonné l’évolution d’Homo sapiens, à travers l’analyse de Ludovic Slimak dans Sapiens nu. Explorez les dynamiques collectives, les dangers du conformisme et le rôle de l’imagination dans notre histoire et nos sociétés modernes.