🍃 Les animaux sauvages à la rescousse de notre âme
Traversons-nous une crise symbolique ? Jung nous le rappelait : quand la conscience rationnelle se coupe des images profondes de l’inconscient collectif, l’âme se dessèche. Le vide, l’angoisse, la solitude existentielle s’installent. Comment recoudre ce lien ? Parfois, un animal suffit à nous reconnecter.
Création visuelle : Pierre Guité et Mid-Journey - Un levraut fragile, blotti dans la chaleur d’une main : la tendresse du sauvage.
Selon Carl Gustav Jung, l’âme humaine n’est pas uniquement consciente. Elle est aussi constituée d’archétypes hérités depuis les origines de l’humanité. Il existerait, selon lui, un conflit profond entre la conscience rationnelle et l'inconscient collectif. Ces archétypes influencent nos pensées, nos émotions et nos comportements, sans que nous en soyons pleinement conscients.
Par notre rationalisme et notre individualisme extrêmes, nous tendons à négliger, voire à réprimer, ces éléments inconscients. Cela provoque un déséquilibre, des angoisses, des névroses et un sentiment de vide existentiel. Lorsque la conscience se sépare trop nettement de l’inconscient, les individus ressentent un sentiment profond de solitude et de perte de sens. C’est précisément dans cette rupture entre l’individu et les images symboliques profondes de l’inconscient collectif que résident les problèmes de l'âme moderne.
Comment se reconnecter ?
C'est ici que les animaux sauvages entrent en scène, non comme simples compagnons, mais comme médiateurs entre notre conscience étriquée et ces archétypes oubliés. L'animal incarne ce que Jung appelait l'âme instinctive — cette part de nous qui sait sans réfléchir.
Tenter de retrouver une certaine harmonie avec la nature ouvrirait une voie vers un nouvel équilibre. Depuis quelques années, de nombreux ouvrages sont publiés décrivant la relation que les auteurs ont développée avec des animaux sauvages.
Par exemple, le livre de Catherine Raven, Fox and I, dans lequel l’auteure raconte son amitié improbable avec un renard sauvage. Catherine a grandi dans un foyer abusif et se sentait isolée. Sa vie a changé grâce à la confiance que lui a témoignée un renard qui lui rendait régulièrement visite. Cette relation lui a permis de développer une estime de soi.
Helen Macdonald avec H is for Hawk, Carl Safina avec Alfie and Me (un hibou malade trouvé puis élevé par l’auteur), et Frieda Hughes avec son livre George consacré à une pie espiègle racontent comment les auteurs ont vu leur vie transformée par le contact inédit avec un animal sauvage.
Ces récits ont plusieurs points communs : souvent, les auteurs traversent des périodes difficiles (deuil, trauma, perte) et trouvent dans ces relations un réconfort inattendu. Ces contacts avec des animaux sauvages développent leur empathie et leur compassion. Ils modifient la perception qu’ont les auteurs d’eux-mêmes.
Ces récits possèdent souvent une tension narrative liée à la fragilité et à la brièveté de ces relations exceptionnelles. Frieda Hughes décrit ainsi comment elle a profondément ressenti la perte de George, sa pie apprivoisée, lorsqu'elle l’a quittée. Catherine Raven, quant à elle, n’a plus revu son renard suite à un feu de forêt.
Ces récits connaissent un grand succès car ils répondent à un besoin humain profond et ancestral : celui de nouer des liens étroits avec le monde animal. Ils offrent un regard privilégié sur des animaux sauvages que la plupart d’entre nous ne rencontreront jamais de près, tout en enrichissant la perception que nous avons de notre propre humanité.
Chloe Dalton et son lièvre
Au petit matin, Chloe découvre un levraut à peine âgé de quelques jours, abandonné et exposé au danger sur un chemin de campagne. Incertaine mais poussée par un instinct protecteur, elle décide de recueillir temporairement l'animal afin de le sauver des prédateurs et d'une mort certaine, et ce, malgré les avertissements d'un expert local qui affirme qu'il est presque impossible d'élever un lièvre sauvage en captivité.
Les premières semaines s’avèrent délicates. Chloe apprend peu à peu les besoins spécifiques de son protégé. Elle découvre que les levrauts sont extrêmement fragiles et que leur survie dépend d'une alimentation adaptée et d'un environnement calme, afin d'éviter tout stress. Elle commence à nourrir l'animal avec un substitut de lait destiné aux chatons et construit un nid improvisé à partir d'herbes sèches, reproduisant ainsi son habitat naturel.
Au fil des jours et des semaines, une relation profonde se noue entre elle et le levraut, bien qu'elle veille à ne pas le domestiquer totalement afin de préserver ses instincts naturels. Elle observe avec fascination son développement physique rapide, la précision de ses mouvements et les nuances infinies de sa fourrure qui lui permettent de se camoufler.
Les premières tétées
Les premiers jours, nourrir le levraut est une véritable épreuve. Chloé doit improviser avec une pipette destinée aux cosmétiques. Elle décrit comment le levraut agrippe avec délicatesse la bouteille de ses minuscules pattes. Ces moments renforcent leur attachement mutuel.
Un langage secret
Le levraut développe peu à peu un son doux et presque inaudible, « chit-chit-chit », lorsqu’il explore la maison ou se trouve près d’elle. Plus tard, il produit même une sorte de chant discret, « un son musical inexplicable », alors qu’elle avait lu que les lièvres ne possédaient pas de véritables cordes vocales. Ce langage secret devient une manifestation d’affection et de tranquillité, un langage qui n’a de cesse d’intriguer Chloé.
Le refus d’être enfermé
L’une des anecdotes les plus frappantes se produit lorsque Chloe suit les conseils d'un site spécialisé et construit un enclos sécurisé pour le levraut, pensant ainsi le protéger. Très vite, celui-ci manifeste son stress et son inconfort en laissant des marques d’urine inhabituelles, voire inquiétantes. Chloe comprend immédiatement son erreur, démonte l’enclos et redonne au levraut sa liberté dans la maison. Ce geste marque un tournant fort dans leur relation, où Chloe respecte désormais pleinement les instincts naturels du lièvre.
Un visiteur inattendu
Avec le temps, le levraut apprend à monter les escaliers vers la chambre à coucher de Chloe. Il prend l’habitude de dormir sous son lit pendant qu’elle travaille, juste au-dessus de son bureau. Parfois, il descend discrètement les marches, s’installe derrière elle et écoute calmement ses appels en visioconférence. Chloe s’émerveille devant la capacité d’un animal sauvage à devenir aussi calme et à l’aise dans un environnement humain.
Des goûts alimentaires surprenants
Chloe décrit avec amusement et tendresse les tentatives pour trouver les préférences culinaires du levraut. Il refuse les fraises, mais adore les framboises, les dégustant lentement, méthodiquement, comme un gourmet.
Un miroir de soi
Enfin, l’un des aspects les plus intrigants du récit est la façon dont la relation avec le levraut devient, pour Chloe, une réflexion profonde sur sa propre vie. Habituée à la vitesse, au stress et aux responsabilités de la vie politique internationale, elle observe chez l’animal une sérénité naturelle, une acceptation instinctive du rythme lent des choses. La présence du levraut devient thérapeutique, modifiant subtilement ses priorités et son rythme personnel.
Chloe voue une véritable admiration pour cet animal. Elle refuse de lui donner un nom afin de marquer une distance nécessaire pour préserver sa nature sauvage. Néanmoins, elle l'appelle tendrement little one (petit). Ce lien singulier lui offre aussi un moyen de réfléchir à sa propre vie, autrefois centrée sur son travail dans le domaine de la géopolitique. Elle mise désormais sur une vie plus simple, un rythme plus lent.
Le livre explore également les aspects biologiques et écologiques de l’espèce : la vie difficile des lièvres, leur taux élevé de mortalité dû aux prédateurs, aux machines agricoles et à l’urbanisation croissante. Chloe décrit minutieusement les habitudes alimentaires et comportementales du levraut, cherchant constamment à reproduire un environnement aussi naturel que possible pour l’aider à recouvrer un jour son indépendance.
Au fur et à mesure que le levraut grandit, Chloé se prépare progressivement à le relâcher dans la nature, consciente que malgré son affection, son destin doit être celui d'un animal sauvage libre, non d'un animal domestiqué ou captif. L’histoire devient ainsi une méditation sur le respect profond de la vie sauvage et les limites de l’intervention humaine.
Raising Hare est autant un récit intime qu’un témoignage poétique sur la beauté, la vulnérabilité et l’importance de préserver la faune sauvage. C'est aussi l'histoire d'une transformation personnelle profonde, où l'auteure découvre une connexion inattendue avec la nature à travers un être vivant fragile, révélant les tensions entre amour, attachement et nécessité de liberté.
Références
Alexandra Alter, A Hare, a Fox, an Owl, a Snail: Animal Memoirs Are Going Wild, New York Times.
C.G. Jung, Problèmes de l’âme moderne, Buchet Chastel.
Chloe Dalton, Raising Hare, Canongate.
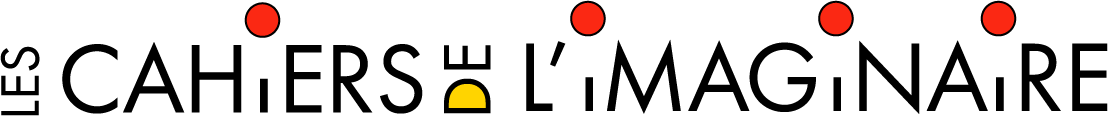

Face à l’urgence climatique, l’architecte Mariam Issoufou réinvente l’architecture bioclimatique en intégrant savoirs ancestraux et innovations durables.